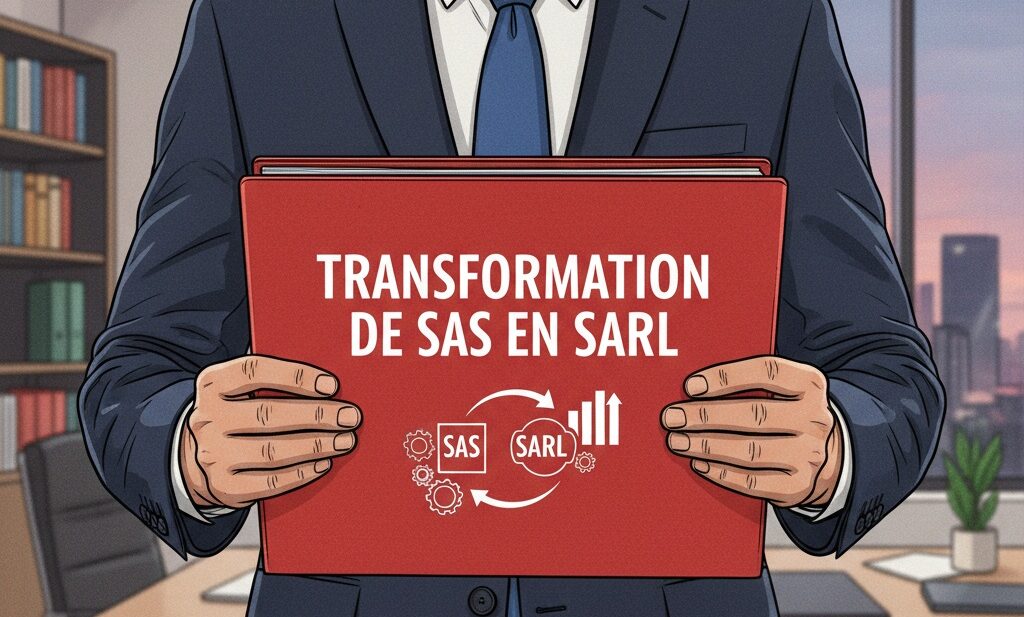Le choix de la forme juridique d’une entreprise n’est jamais définitif. Une Société par Actions Simplifiée (SAS) peut, à un certain stade de son développement, envisager de devenir une Société à Responsabilité Limitée (SARL).
Cette transformation n’est pas un simple ajustement administratif, elle répond souvent à des motivations stratégiques et opérationnelles précises, touchant notamment la gestion quotidienne, le régime social des dirigeants ou la composition de l’actionnariat. L’examen de ces raisons permet de comprendre pourquoi des entreprises franchissent cette étape.
Les motivations derrière le passage d’une SAS à une SARL
Plusieurs raisons peuvent pousser les dirigeants d’une SAS à opter pour la structure d’une SARL. Ces choix découlent d’une analyse des besoins actuels de l’entreprise et de ses perspectives.
Optimiser le régime social du dirigeant
C’est souvent une motivation première. En SAS, le président est affilié au régime général de la Sécurité sociale, assimilé à un salarié, même s’il ne bénéficie pas de l’assurance chômage. Ses cotisations sociales sont comparables à celles d’un salarié. En SARL, si le gérant est majoritaire (il détient plus de 50% des parts sociales), il relève du régime des travailleurs non salariés (TNS).
Ce régime se caractérise par des cotisations sociales généralement moins élevées que celles du régime général, ce qui peut représenter une économie significative sur la rémunération du dirigeant, tout en offrant une couverture sociale. Pour un chef d’entreprise cherchant à réduire le coût de ses charges, ce point est un facteur déterminant.
Rechercher une gouvernance simplifiée et encadrée
La SAS est reconnue pour sa flexibilité statutaire. Les associés ont une grande liberté pour organiser le fonctionnement de la société dans les statuts. Cette souplesse peut, paradoxalement, devenir une contrainte si les statuts sont mal rédigés ou si les associés préfèrent un cadre juridique plus établi. La SARL offre une gouvernance plus rigide, mais également plus simple et prévisible.
Les règles de fonctionnement, de décision et de cession de parts sont davantage définies par la loi, limitant ainsi les risques de litiges et simplifiant les processus internes. Pour des entreprises qui n’ont pas besoin d’une grande inventivité statutaire, la SARL propose un cadre sécurisant et facile à appréhender.
Adapter la forme juridique à un cadre familial ou à des associés moins nombreux
La SARL est historiquement associée aux entreprises de taille modeste, souvent familiales, ou celles dont les associés sont liés par des considérations personnelles fortes (on parle d’ intuitu personae). Les règles de la SARL, notamment celles concernant l’agrément pour la cession de parts sociales, renforcent ce caractère. Il est généralement plus simple de bloquer l’entrée de nouveaux associés non désirés en SARL qu’en SAS, où la cession est, par défaut, plus libre.
Pour une entreprise souhaitant maintenir un cercle d’associés restreint et stable, ou pour une transmission d’entreprise au sein de la famille, la SARL peut se révéler plus adaptée.
Renforcer la protection des associés minoritaires
Bien que la flexibilité de la SAS permette de prévoir des mécanismes de protection des associés minoritaires dans les statuts, la SARL offre un cadre légal où certaines protections sont intrinsèques. Les droits des associés minoritaires, notamment en matière d’information et de participation aux décisions, sont plus strictement définis par la loi dans une SARL. Cela peut rassurer des associés qui souhaitent une garantie juridique plus forte, sans avoir à la négocier dans des statuts complexes.
Le rôle du commissaire à la transformation : un garant de l’opération
La transformation d’une SAS en SARL est une opération qui nécessite parfois l’intervention d’un commissaire à la transformation. Ce professionnel est mandaté pour assurer la protection des associés et des tiers, en particulier des créanciers.
Sa mission consiste à vérifier que la valeur des biens composant l’actif social correspond au moins au montant du capital social. Il s’assure que les capitaux propres de la société sont au moins égaux à son capital social.
Son rapport atteste de la valeur des actifs et des passifs et confirme la situation financière de la société. Ce contrôle est requis pour garantir la fidélité des informations financières et la viabilité de la nouvelle structure juridique, surtout si la société n’a pas déjà de commissaire aux comptes ou si elle passe d’une forme sans responsabilité limitée à une forme avec responsabilité limitée. Son intervention garantit la transparence et la sécurité juridique de l’opération.